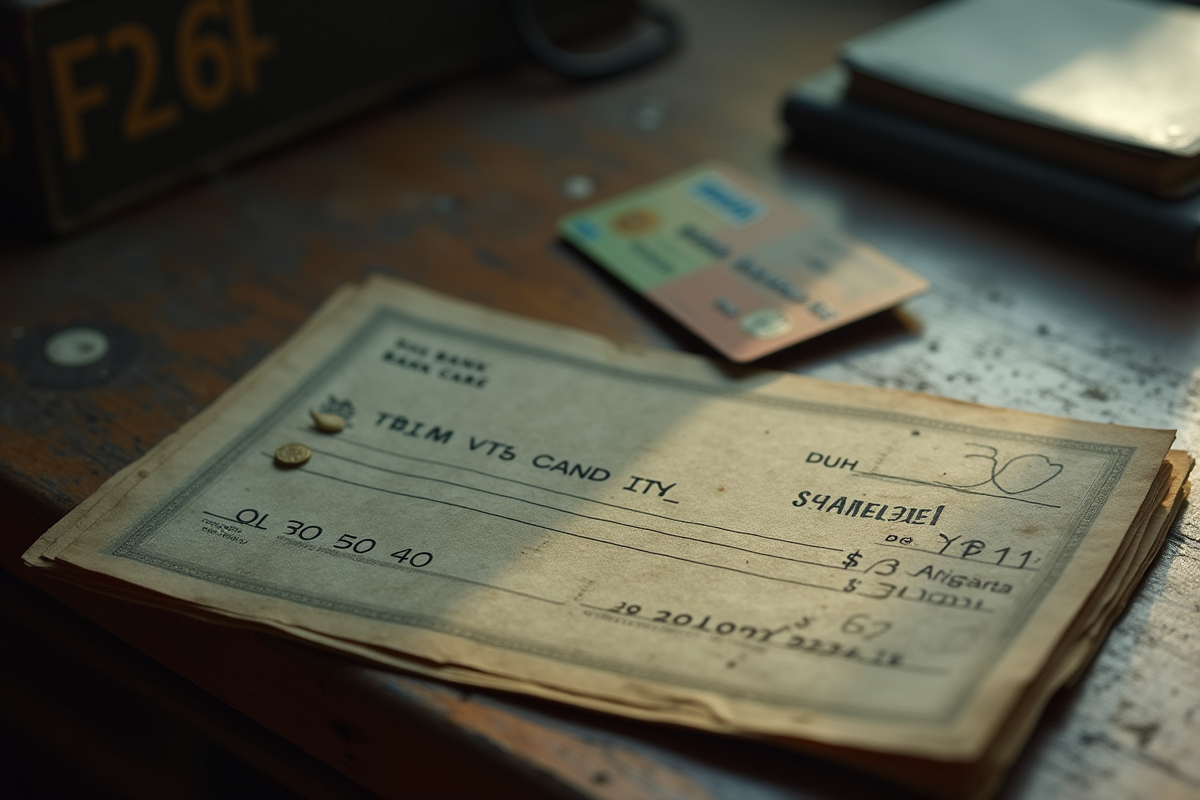Passé cinq ans sans opération, un compte bancaire est déclaré inactif par l’établissement. La loi Eckert impose alors à la banque de rechercher le titulaire ou ses ayants droit et de leur signaler la situation.À l’issue de cette période, les fonds peuvent être transférés à la Caisse des Dépôts. Leur restitution devient ensuite soumise à des démarches spécifiques et à des délais stricts, sous peine de perte définitive des avoirs.
Quand un compte bancaire devient-il inactif et pourquoi cela arrive-t-il ?
Un compte bancaire inactif n’est pas un simple oubli. C’est une situation encadrée depuis 2016 par la loi Eckert : compte courant, livret, assurance-vie, aucun produit n’y échappe. L’inactivité est établie au bout de douze mois sans mouvement initié par le titulaire ou son représentant légal. En cas de décès, le délai commence douze mois après le décès, à condition que les ayants droit n’aient pas donné signe de vie.
La banque ne se contente pas d’archiver : elle est tenue de suivre l’état des comptes. Sans retrait, dépôt, ni même une simple connexion au compte, ce dernier est repéré comme inactif et le décompte commence. Au bout de cinq ans, la mention inactif s’impose.
Plusieurs types de comptes et de durées sont touchés par ce mécanisme :
- Comptes concernés : comptes courants, livrets d’épargne, comptes-titres, coffres, produits d’épargne réglementés.
Concernant les délais, tout dépend du compte :
- Période d’inactivité : en règle générale, cinq ans ; mais seulement douze mois après le décès du titulaire si aucun héritier ne s’est manifesté.
Différents types d’opérations sont pris en compte pour éviter l’inactivité :
- Opérations prises en compte : tout mouvement effectué par le titulaire ou un mandataire, voire toute preuve d’intérêt comme une réponse aux courriers de la banque.
Pourquoi autant de comptes finissent ainsi ? Changement de domiciliation, décès non signalé, ouverture pour une opération ponctuelle ou simple oubli, chaque facteur gonfle silencieusement le stock de comptes bancaires dormants. Ces avoirs non réclamés occupent une place croissante au sein de la Caisse des Dépôts.
Loi Eckert : ce que prévoit la réglementation pour les comptes inactifs
Depuis son entrée en vigueur, la loi Eckert impose aux banques une procédure stricte de surveillance et d’information sur les comptes bancaires inactifs. Une fois la période sans activité atteinte, l’établissement doit contacter le client ou, le cas échéant, ses ayants droit en cas de décès. Cette démarche est annuelle et ne néglige personne : compte courant comme livret d’épargne, contrats d’assurance vie inclus.
Après cinq ans sans intervention, la banque procède à la clôture du compte et transfère intégralement les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Pour les contrats d’assurance vie restés sans nouvelle du bénéficiaire, le transfert s’effectue au bout de dix ans (vingt en cas de décès avéré du titulaire). La CDC détient alors ces sommes pendant vingt années supplémentaires. Si aucun titulaire ou ayant droit ne se signale, l’État absorbe définitivement ces fonds.
Plusieurs précautions sont à garder en tête :
- Frais d’inactivité : la banque peut facturer certains frais, mais leur montant est plafonné et transparent. Les produits d’épargne réglementés échappent à tout prélèvement.
- Identification des titulaires : les établissements s’appuient sur le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP de l’INSEE) pour vérifier l’éventuel décès des clients.
- Statistiques sur comptes inactifs : chaque année, les banques révèlent, chiffres à l’appui, combien de comptes inactifs et quel montant total ont été transférés à la CDC.
Ce protocole concerne toutes les banques, du Crédit Mutuel à Banque BCP. Malgré cette vigilance, nombreux sont les clients pris de court, découvrant des fonds ou des frais longtemps après coup. D’où l’obligation de clarté posée par la réglementation, qui suit le dossier jusqu’à la porte de la CDC.
Conséquences concrètes et solutions pour récupérer ou préserver vos avoirs
Les règles sont strictes : cinq ans d’inactivité sur un compte bancaire, et les fonds ne dorment plus à la banque. Ils sont transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Dès lors, le titulaire ou les ayants droit doivent changer d’interlocuteur pour récupérer les sommes. Plus question de demander un virement à la banque d’origine : toute réclamation se fait désormais auprès de la CDC, via une procédure exigeante.
Pour solliciter la restitution d’avoirs oubliés, il faut fournir sa pièce d’identité et prouver son lien avec le compte. En cas de succession, la marche est plus longue : acte de décès, justificatifs de parenté ou acte notarié peuvent être exigés. Ces démarches, si elles prennent du temps, permettent d’éviter le transfert définitif à l’État après vingt ans.
Pour éviter que l’argent ne soit bloqué ou ne disparaisse, trois réflexes sont à cultiver :
- Préserver ses avoirs : effectuer au moins un petit mouvement chaque année, même minime, suffit à maintenir le compte actif.
- Informer ses proches : communiquer à sa famille ou à son notaire la liste de ses comptes simplifie la succession et prévient les oublis coûteux.
- Surveiller les courriers : toute alerte reçue sur l’inactivité d’un compte doit être prise au sérieux, car elle précède le transfert à la CDC.
L’institution bancaire comme la CDC n’ont pas le droit de ponctionner ces avoirs en dehors des frais réglementaires. Les fonds restent disponibles à condition d’entreprendre, dans les temps, les démarches prévues. Prendre les devants, c’est éviter de voir s’échapper ce qui vous appartient, même modeste.
Un compte inanimé peut être récupéré avec méthode, à condition de ne pas laisser dormir l’information. Prévenir, transmettre, vérifier : de tels automatismes valent mieux qu’un rendez-vous forcé avec la Caisse des Dépôts. Un mouvement dans l’année, une liste à jour, une vigilance sur le courrier, et l’histoire financière de chacun garde toutes ses chances de rester intacte.